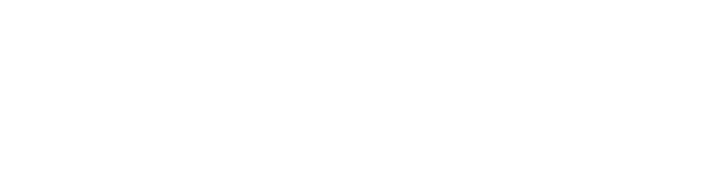Dans le cadre de l’Observatoire Hommes-Milieux Nunavik (OHMI-Nunavik) et du projet LATITUDE (MITI-CNRS), plusieurs sites du Nunavik (Québec nordique, Canada) ont été explorés à l’été puis à l’automne 2024 : Kuujjuarapik, Umiujaq, lac Wiyâshâkimî, Salluit, Kangiqsualujjuaq et Kangiqsujuaq (photo 1). Ces sites appartiennent à un réseau de onze stations d’observation couvrant le Nunavik, les îles de Baffin et d’Ellesmere dans le Haut-Arctique canadien. L’objectif est d’étudier l’impact des changements climatiques sur divers compartiments environnementaux.
Photo 1 - L’embouchure de la rivière d’Umiujaq dans la baie d’Hudson, sous les premières neiges hivernales
Crédit photo : Armelle Decaulne, octobre 2024.
Depuis 2015, les recherches au Nunavik se concentrent sur les dynamiques de pente, particulièrement les aléas gravitaires potentiellement générateurs de risque. Avalanches, chutes de blocs et glissements de terrain traduisent des environnements en mutation rapide, à l’origine de catastrophes, comme l’avalanche de 1999 à Kangiqsualujjuaq (9 morts, 25 blessés). Depuis 2017, des pièges photographiques automatiques et diverses analyses de terrain et de laboratoire en assurent un suivi précis. En 2024, toutes les données photographiques ont été collectées et complétées par des relevés stratigraphiques et dendrochronologiques, permettant une datation et une cartographie fines des aléas gravitaires près des zones habitées ou touristiques.
Parallèlement, nous étudions l’impact des changements climatiques sur les oiseaux le long d’un gradient de 3 000 km, de Radisson (53°N) au Haut-Arctique (Alert, 82°N ; Ward Hunt, 83°N), grâce à un suivi acoustique passif (photo 2). Chaque année, deux enregistreurs par site captent les chants d’avril à juillet. L’expansion d’espèces méridionales s’oppose au déclin des espèces arctiques. Quatre questions guident ce suivi : (1) Quels sont les réassemblages des communautés ? (2) Quelles sont les modifications des dates d’arrivée sur les sites de nidification ? (3) La phénologie du chant change-t-elle ? (4) Les rythmes circadiens d’activité vocale changent-ils sur le long terme ? En 2024, tous les sites ont été équipés et les appareils relevés sur trois d’entre eux fournissent déjà des données sur les dates d’arrivée et les rythmes d’activité de plusieurs espèces.
Photo 2 - Bruant à couronne blanche à Umiujaq, un des oiseaux les plus communs au Nunavik
Crédit photo : Laurent Godet, juillet 2024.
Laurent GODET, Biogéographe, Directeur de recherche au CNRS, Nantes Université, LETG Nantes UMR 6554 CNRS
Armelle DECAULNE, Géomorphologue, Directrice de recherche au CNRS, Nantes Université, LETG Nantes UMR 6554 CNRS