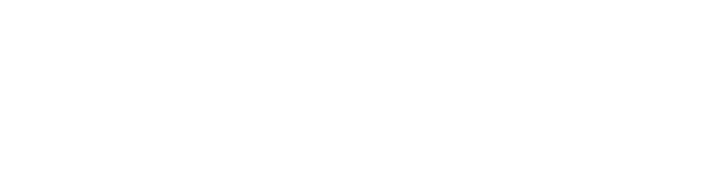Pourquoi et comment devenir chercheure en géographie ?
« En quatrième année de géographie, j'ai réalisé un mémoire de recherche sur une thématique de mon choix. L'invisibilité des personnes handicapées dans l'espace public urbain m'interroge et oriente mon projet de mémoire de géographie sociale. Cette première expérience de recherche s'appuie sur des temps d'observation des espaces publics et la réalisation d'entretiens auprès des acteurs locaux, des personnes en situation de handicap, des chercheurs… Les premiers résultats soulignent les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap au quotidien et le rôle des acteurs pour mettre en œuvre une politique d'accessibilité. À cette période, en France, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est en construction. Le contexte est favorable à l'élaboration d'un projet de thèse (co-dirigé par C. Pihet et S. Fleuret) autour du handicap, du vieillissement et de l'accessibilité. Les terrains de recherche en France et au Québec permettent d'appréhender la dimension internationale de l'accessibilité et ouvrent de nouvelles pistes de recherche… »
Quelles sont les difficultés rencontrées dans le domaine de la recherche ?
« Les difficultés liées au financement de la recherche, au poids des charges administratives ont été évoquées dans les numéros précédents. En tant qu'enseignante et chercheure, l'une des difficultés consiste à trouver un équilibre entre les missions pédagogique et de recherche. Plusieurs dispositifs permettent aux enseignants-chercheurs de bénéficier d'une période dédiée exclusivement à la recherche et de cesser leur activité d'enseignement temporairement. Par exemple, l'accueil en délégation auprès du Centre national de recherche scientifique (CNRS) est un dispositif qui permet aux enseignants-chercheurs de se consacrer à leur projet de recherche pour une durée de six mois à un an. C'est ce dispositif qui me permet de consacrer l'année 2024-2025 à mon activité de recherche. »
Quel est le thème de ton dernier programme de recherche ?
Le projet de recherche, que je mène pendant cette année de délégation auprès du CNRS, porte sur l'articulation entre les politiques locales de l'habitat et les politiques d'accessibilité dans les métropoles françaises. Vingt ans après la loi du 11 février 2005 qui posait pour la première fois, des échéances et un calendrier de mise en accessibilité du « cadre bâti, de la voirie, des aménagements des espaces publics, les systèmes de transports et leur intermodalité » (art. 45 loi n° 2005-102), les inégalités territoriales en matière d'accessibilité sont constatées dans tous les domaines : logement, transport, éducation, emploi, etc. Au regard de ces inégalités, l'étude des dispositifs territoriaux en faveur de l'accessibilité et de l'habitat est l'un des objectifs de ce projet de recherche. Cette recherche se prolonge avec l'analyse des récits d'expériences des personnes en situation de handicap en matière d'habitat et d'accessibilité lors d'ateliers participatifs avec les habitants.
Quel est ton meilleur souvenir de chercheure ?
Qu'il s'agisse de projet de recherche, de publications scientifiques, de missions de terrain, la recherche est le résultat d'une collaboration entre les acteurs de la recherche. Les ateliers avec les habitants, avec les professionnels de l'aménagement sont des moments précieux de la recherche où les singularités des expériences d'habiter et pratiques des espaces sont partagées. Aussi, les rencontres avec les équipes de recherche internationales, lors des premiers terrains de thèse au Québec, puis au moment des colloques internationaux de géographie de la santé ou dans les programmes européens ont marqué mon parcours de chercheure.
Pour terminer, une anecdote sur la recherche à l'IGARUN ?
La revue annuelle Les Cahiers Nantais valorise la production géographique des chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs d'études et de recherche, cartographes et étudiants en formation à l'Institut de géographie et d'aménagement de Nantes Université (IGARUN). Les étudiants ont l'occasion de découvrir le processus d'écriture d'un article scientifique suite à la réalisation d'un diagnostic de territoire ou d'un mémoire de recherche en master. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à découvrir ces articles !