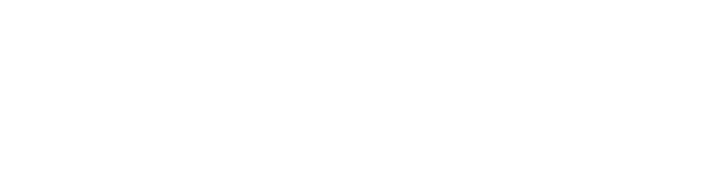Pourquoi et comment devient-on chercheur en géographie ?
« Traditionnellement, on attend d'un·e chercheur·e qu'il ou elle soit quelqu'un de hautement spécialisé dans un domaine très spécifique. Mais je crois que ce profil évolue de plus en plus, et pour moi, un·e bon·ne chercheur·e est quelqu'un capable de regarder et de questionner les choses d'un point de vue multidisciplinaire. À mon avis, la géographie apporte justement cette perspective. Elle crée des ponts. Elle connecte la physique, les mathématiques, la biologie, l'histoire, la philosophie et elle vous donne des outils pour observer le monde de manière plus intégrée.
"Pourquoi ? Comment ?". Ce sont les questions qui animent la ou le chercheur·e. Si, en répondant à ces questions, vous trouvez de nouveaux "Pourquoi" et "Comment", c'est parfait. Cela signifie que vous êtes en mouvement. »
Quelles sont les difficultés rencontrées dans le domaine de la recherche ?
« J'ai un fichier .txt sur mon ordinateur où je note toutes les idées de recherche qui me viennent. La difficulté est de trouver le temps pour tester et poursuivre toutes ces idées car notre travail ne se limite pas à la recherche. Il y a aussi l'administratif, la recherche de financements, qui occupent une grande partie de notre activité.
Je pense que beaucoup d'autres difficultés, comme la compétitivité, qui peut devenir prédatrice ou le manque de ressources, apparaissent lorsque la recherche est traitée comme un produit commercial plutôt que comme un moyen d'éducation, de développement et de transformation de la société. »
Quel est ton dernier article/ta dernière mission ? Quel était le thème de recherche ?
« En Europe, quand on parle du Brésil, les gens s'intéressent immédiatement à l'Amazonie. Je me considère un peu comme un porte-parole étranger d'une autre partie du Brésil : la région nord-est. Avec ses paysages semi-arides, sa culture et sa biodiversité riches mais peu étudiées scientifiquement, cette région mérite plus d'attention en dehors du Brésil.
Actuellement, je termine un séjour d'une année à l'IGARUN, où je collabore avec des partenaires du laboratoire LETG. Nos recherches portent sur les interactions entre l'atmosphère et la surface (climat-végétation) dans cette région semi-aride du Brésil.
Par exemple, nous savons que la végétation semi-aride est bien adaptée et résiliente aux sécheresses. L'une des questions auxquelles nous essayons de répondre est la suivante : comment, dans un contexte de changement climatique avec des sécheresses plus sévères et plus longues, ces écosystèmes vont-ils réagir ? »
Quel est ton meilleur souvenir de chercheur ?
« Ce n'est pas seulement un souvenir du passé, mais quelque chose que je garde à l'esprit tous les jours et que j'espère ne jamais oublier dans le futur : chercher, c'est apprendre. Apprendre sur les sujets que je recherche, bien sûr, mais aussi apprendre à développer mes rapports avec les autres, à enseigner et à découvrir la diversité. Je trouve fantastique de pouvoir dire que mon travail de chercheur est, en fin de compte, d'apprendre. »
Pour terminer, une anecdote sur la recherche à l'IGARUN ?
« J'ai effectué une partie de mon doctorat en 2019, ici à l'IGARUN, et je suis revenu en 2024 en tant que post-doc et maître de conférences dans une université brésilienne. En plus de renforcer les partenariats existants, je crée de nouveaux réseaux et j'espère revenir le plus tôt possible à Nantes où les personnes du laboratoire LETG m'ont toujours chaleureusement accueilli. »