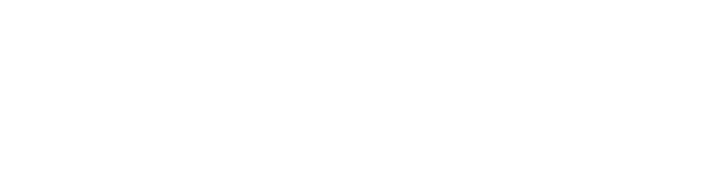Jean-Max Palierne est mort le 23 février 2024 ; il avait 92 ans, une belle vitalité chez cet homme qui a pourtant souffert bien des misères au cours de cette longue vie. Né à Madagascar en 1931, ses rapports difficiles avec son père forgèrent un caractère fortement « résistant » qu’il manifesta tout au long de sa vie. Il mena ses études à la force de ce caractère et connut tout du monde de l’éducation nationale. « Pion » comme disait sans élégance celui qui dirigea sa thèse, donc surveillant d’externat, avant d’entamer des études supérieures que l’on peut dire d’autant plus brillantes qu’elles s’accomplirent dans un contexte chaotique qui marquait en quelque sorte la fin de la France coloniale. Il dut « prouver » qu’il était français lorsque Madagascar devint indépendante. Une blessure qui rejoignait tout ce qu’il dut subir dans le massif de l’Aurès en 1955 au tout début de la guerre d’Algérie où il servit dans les troupes coloniales. Il sut s’en souvenir et certainement s’en servir dans les années qui suivirent. Sa vie fut un combat permanent pour s’affirmer face aux autres mais aussi pour vivre car il dut subir tout au long des années une longue série d’interventions chirurgicales qui, en quelque sorte, manifestèrent sa formidable envie de vivre. Comme il le disait dans une lettre récente « j’ai pu, en temps voulu, dire ce que j’avais appris de la VIE ». Ce qui explique son engagement de géographe et le parcours pour le moins original qu’il sut construire autour de la biogéographie. Bien qu’il l’ait peu cité, il s’inscrit dans le sillon de Max Sorre qui fut ce pionnier qui annonçait bien avant d’autres géographes que la question environnementale deviendrait cardinale dans le monde contemporain. Il est ainsi des rapprochements que Palierne n’aurait peut-être pas entièrement partagés.
Reçu à l’agrégation de géographie, il fut affecté au lycée Jules Verne à Nantes ; rapidement sollicité d’entrer dans l’enseignement supérieur entre diverses facultés (Caen, Paris…) il choisit finalement Nantes où il retrouva Jacques Gras qui fondait l’Institut. Il rejoignit ainsi en 1967 l’équipe, peu nombreuse mais dynamique, qui couvrait à peu près tous les domaines de la géographie. Il y apportait une autre dimension, celle des formations végétales, celle de la biogéographie, achevant ses travaux de recherche en forêt du Gâvres sous la direction assez lointaine d’André Meynier. Il soutint cette thèse en 1975 sous le titre suivant « les forêts et leur environnement dans les pays ligéro-atlantiques nord », un titre classique sinon banal, n’eût été le sous-titre qui annonçait tout le reste : Recherches et Réflexions Biogéographiques sur les Discontinuités et la Dynamique des Paysages Naturels et Humains. Toutes ces majuscules disent le grand souci pédagogique de Jean-Max Palierne, comme l’art, peu usité dans une thèse, de souligner certains mots et certaines phrases pour mieux marquer l’attention du lecteur ; l’art de persuader, l’art de convaincre ou encore l’art de provoquer le débat. Tel il était déjà dans cette thèse. La suite s’inscrivit plus fortement encore dans cette démarche et dans tous les problèmes posés en 1975. En revanche, au sein d’une biogéographie qui progressivement s’est orientée vers les questions de gestion et d’aménagement, plus « humaine » en quelque sorte, Palierne n’a pas dévié, il est resté en l’approfondissant sur sa marge forestière, sur la fragilité de ces marges (forêts du littoral vendéen, Landes…). Sa biogéographie est devenue une « géobiologie », terme qui apparait dès l’introduction de sa thèse, tirant sa recherche et ses réflexions vers le « vivant », très imprégné des idées de François Jacob dans « la logique du vivant » (1970). Rares sont les géographes – et qui se reconnaissent encore comme tels – qui ont osé aller dans un domaine réputé relever des sciences dures. De la forêt ou de la diversité des associations végétales, son sujet d’étude est devenu l’arbre, dans sa physionomie, dans son comportement : passant de la vieille question de l’empâtement de la base à la mise en évidence de la diplasie comme stratégie d’adaptation à un environnement contraignant, on peut même dire comme stratégie de survie. Avec Palierne, l’arbre était « vivant » et pour le comprendre il fallait descendre au plus bas niveau, à la cellule et l’organisation cellulaire.
Il aura à la fois peu et beaucoup publié. De manière académique d’abord, dans des revues de géographie, dans les Cahiers Nantais en particulier où, dans un numéro d’Hommage pour son départ à la retraite il put longuement définir ce qu’il entendait par diplasie (Le vivant et l’inerte, intelligence et stratégies de survie chez les espèces arborescentes - Cahiers Nantais, n° 38, janvier 1992). Sa retraite fut très active. Du terrain toujours pour observer, mesurer, du laboratoire encore pour changer d’échelle de perception, de compréhension. Il publia à compte d’auteur, à la fois pour régler quelques comptes mais surtout pour approfondir ses recherches, mettant au clair les liens existant dans la nature mais sans négliger ce que l’occupation humaine avait pu en quelque sorte « déranger » dans l’ordre de la nature forestière en forçant plus que jamais les espèces à s’adapter à ces contraintes nouvelles. Les titres disent l’essentiel : Les arbres et la maîtrise de l’espace et du temps par leurs grandes stratégies de survie (2014) ; Entre splendeur et épouvante ou la vie, intelligente et implacable (2020) ; Les clés des champs (2021) ; Habeat corpus de l’arbre (intelligence et stratégies adaptatives en parcours biogéonomique) (2022) et enfin, peut-être l’ultime, Du même au presque même honneur à l’arbre, maître de vie et à sa discipline de fondation, la diplasie (2023). Des écrits dont l’abondance annonce la fin comme fait le chêne en ses derniers instants. Arbre de vie mais aussi vie pour l’arbre !
Il n’est pas possible dans une nécrologie qui est à la fois une histoire de vie et un hommage au biogéographe passionné, de présenter toute la personnalité d’un collègue devenu un ami, d’un enseignant excellent pédagogue, d’un chercheur actif jusqu’à sa mort.
De 1967 à 1990, les étudiants géographes et historiens ont pu apprécier ses cours de géographie régionale et ses magnifiques croquis dessinés au tableau, les TD de climatologie ou encore les séances de recherches novatrices en biogéographie, dans le labo ; d’autres retiennent la découverte des forêts, des paysages agraires, des sols lors des nombreuses études de terrain qu’il réalisa en Loire-Atlantique et en Vendée (dès 1963 lors d’une excursion de licence organisée par Jacques Gras dans la forêt du Gâvre pour la première promotion de géographes !), l’aide bienveillante lors d’un oral d’examen, la préparation d’un mémoire de maîtrise. Les collègues amateurs du petit café dans la salle des profs avant le cours de 8 heures ou réunis dans la bibliothèque près de la photocopieuse n’oublient pas les discussions passionnées et parfois ses diatribes à propos des réformes universitaires, de l’évolution de la géographie, mais aussi de la vie politique, de la littérature, de la peinture, des ordinateurs ou de la cartographie !
Les jeunes collègues recrutés comme assistants en 1969 (Le Rhun, Croix) et 1970 (Chauvet) ont apprécié son accueil chaleureux, son aide efficace, et lors des nombreuses manifestations universitaires qui ont eu lieu durant les décennies 1970 et 1980, son soutien actif, au prix d’un doigt cassé, lorsque des étudiants envahirent violemment la salle de cours 208 (1976, réforme d’Alice Saunier-Seité). Ses collègues qui ont plus particulièrement travaillé sur l’évolution des campagnes et des paysages de Bretagne et de Vendée (Renard, Le Rhun, Chauvet, Croix) ont utilisé et transmis aux étudiants ses recherches novatrices sur les différents bocages : bocage originel, bocage mimétique plus récent, moins lié voire indifférent aux qualités des sols, à la forme de la pente ou à l’exposition, bocage parfois accompagné de champs ouverts (gaigneries). Prenant en compte les recherches de Jean-Max Palierne et de sa collègue biogéographe Jeanne Dufour professeur d’université au Mans, ces enseignants-chercheurs ont eux-aussi fortement souligné dans leurs travaux pour les directions départementales d’Agriculture ou dans les commissions communales de remembrement (dès les années 1960), que les caractères des différents bocages devaient être pris en compte, en particulier lors des travaux connexes au regroupement des parcelles de propriété. Les sinuosités d’un cours d’eau, les talus et certaines haies jouent un rôle important pour lutter contre l’érosion, ralentir les crues diminuer les inondations y compris pour les ruisseaux !!!
La plupart des lecteurs de cette notice ne l’ont pas connu, et sans doute ne l’ont pas lu ! Peu de ses travaux ont été édités durant sa carrière universitaire faute d’éditeur curieux et courageux, mais à partir des années 1990, il a commencé à construire un site internet mis à jour et développé par la biogéographe Édith Renaud. Thèse de doctorat d’État, articles, livres et même « humeurs » y figurent. C’est un outil essentiel pour connaître Jean-Max Palierne, réfléchir à partir de ses travaux novateurs, et comme il l’a toujours fait, essayer de « comprendre la VIE ».